Juan de Flandes (Flandres, c.1460/65 ?-Palencia ?, c.1519),
La Crucifixion, c.1509-1518.
Huile sur bois, 123 x 169 cm, Madrid, Musée du Prado.
[image en haute définition ici]
Pour se convaincre de l’intensité des échanges entre Nord et Sud, Espagne et Flandres en l’occurrence, il suffit de se rendre, virtuellement ou réellement, à Madrid, plus précisément au Musée du Prado, afin d’y contempler une des plus importantes réunions de tableaux flamands des XVe et XVIe siècles qui soit au monde, en quantité comme en qualité. La musique, au même titre que la peinture, atteste de cette rencontre entre deux cultures a priori éloignées et de la capacité des compositeurs autochtones à s’approprier la manière septentrionale. Le disque consacré majoritairement à Francisco de Peñalosa, autour de sa Missa Nunca fue pena mayor, que viennent de publier, en collaboration avec le Festival de Maguelone, l’Ensemble Gilles Binchois et Les Sacqueboutiers chez Glossa en offre un passionnant témoignage.
« Parmi les chanteurs de notre chapelle lors des occasions solennelles se trouve notre cher fils, Francisco de Peñalosa (…) musicien extraordinaire [qui] possède un art si exquis (…) que nous désirons ardemment sa présence constante. » Ainsi s’exprime le pape, notoirement mélomane, Léon X pour tenter d’apaiser les récriminations du chapitre de Séville au sujet du séjour romain de son compositeur attitré qui tendait à se prolonger un peu trop à son goût. S’il ne jouit pas aujourd’hui de la même célébrité que Morales ou Victoria, la présence de Peñalosa à Rome en dit long sur la renommée qui était la sienne de son vivant.  Ce fils d’un serviteur de la maison de la reine Isabelle est né à Talavera de la Reina vers 1470 et si l’on est réduit, comme souvent avec les musiciens de cette époque, à des conjectures pour ce qui regarde sa formation, il y a fort à parier qu’elle fut sévillane. Le 11 mai 1498, date de la première mention officielle de son nom, il est engagé en qualité de chanteur de la chapelle royale de Ferdinand II d’Aragon, au service duquel il va demeurer jusqu’à la mort du souverain, en 1516, tout en cumulant, sur le conseil de ce dernier, un canonicat à la cathédrale de Séville, auquel il postule dès la fin de l’année 1505, ainsi qu’un poste de maître de chapelle, à partir de 1511, auprès du prince Ferdinand, fils de Philippe le Beau et de Jeanne la Folle. En 1517, Peñalosa se rend à Rome pour y chanter dans le chœur papal ; il va y demeurer jusqu’à la mort du pontife en décembre 1521, une situation dont nous avons vu qu’elle n’avait pas été sans provoquer quelques tensions. À son retour en Espagne, il retrouve néanmoins son poste à la cathédrale de Séville, où ses messes se sont durablement installées au répertoire comme le démontre le recueil qui en est réalisé vers 1510-1511, et c’est tout naturellement qu’il y trouve sa sépulture à sa mort, le 1er avril 1528.
Ce fils d’un serviteur de la maison de la reine Isabelle est né à Talavera de la Reina vers 1470 et si l’on est réduit, comme souvent avec les musiciens de cette époque, à des conjectures pour ce qui regarde sa formation, il y a fort à parier qu’elle fut sévillane. Le 11 mai 1498, date de la première mention officielle de son nom, il est engagé en qualité de chanteur de la chapelle royale de Ferdinand II d’Aragon, au service duquel il va demeurer jusqu’à la mort du souverain, en 1516, tout en cumulant, sur le conseil de ce dernier, un canonicat à la cathédrale de Séville, auquel il postule dès la fin de l’année 1505, ainsi qu’un poste de maître de chapelle, à partir de 1511, auprès du prince Ferdinand, fils de Philippe le Beau et de Jeanne la Folle. En 1517, Peñalosa se rend à Rome pour y chanter dans le chœur papal ; il va y demeurer jusqu’à la mort du pontife en décembre 1521, une situation dont nous avons vu qu’elle n’avait pas été sans provoquer quelques tensions. À son retour en Espagne, il retrouve néanmoins son poste à la cathédrale de Séville, où ses messes se sont durablement installées au répertoire comme le démontre le recueil qui en est réalisé vers 1510-1511, et c’est tout naturellement qu’il y trouve sa sépulture à sa mort, le 1er avril 1528.
On ignore quand et pour quelle occasion Peñalosa écrivit sa Missa Nunca fue pena mayor, qui utilise comme cantus firmus une chanson, en son temps célébrissime, composée dans les années 1470 par le maître de chapelle du premier duc d’Albe, Juan de Urrede, né Johannes de Wreede à Bruges sans doute au début de la décennie 1430, bel exemple de rencontre entre texte espagnol et polyphonie franco-flamande. Peñalosa n’est d’ailleurs pas le seul à utiliser cette mélodie, puisqu’on possède également une messe de Pierre de la Rue (c.1460-1518), publiée en 1503, qui se fonde sur elle, ce qui a conduit certains chercheurs à supposer que la partition de l’Espagnol pourrait être une réponse à celle de son collègue du Nord, au service de Philippe le Beau, une hypothèse qui permettrait de placer l’œuvre dans la première décennie du XVIe siècle.  Ce qui frappe le plus dans cette messe, que le choix de Nunca fue pena mayor (« Jamais ne fut douleur plus grande ») comme « thème unificateur » teinte fortement de dévotion mariale, la souffrance extrême étant celle de la mère au spectacle de son fils mourant sur la croix, est peut-être, comme souvent chez Peñalosa, son extrême sobriété conjuguée à de remarquables capacités d’invention. Le traitement de la mélodie de la chanson est, à cet égard, révélateur, car si elle se déploie dans toute sa nudité à la voix supérieure dès le premier Kyrie en demeurant parfaitement perceptible et identifiable, le compositeur va ensuite faire montre d’une grande imagination dans son traitement, par exemple en brodant dessus (Christe) ou en la combinant avec des mélodies grégoriennes (Gloria, Credo). Bien que de tels procédés révèlent une maîtrise certaine des techniques d’écriture, l’œuvre sonne néanmoins toujours avec beaucoup de clarté et de simplicité, loin du caractère parfois extrêmement complexe et un rien ostentatoire des polyphonies développées en Flandres. Les mêmes qualités se retrouvent dans les motets proposés en complément de programme, certains d’attribution contestable, comme Memorare Piissima, probablement dû à Pedro de Escobar (c.1465-après 1535), qui semblent marqués par une volonté supérieure d’expressivité, prenant l’auditeur à partie pour mieux le conduire à la méditation, comme le montrent l’utilisation des silences dans Ave vera caro Christi ou la dramatisation d’In passione positus.
Ce qui frappe le plus dans cette messe, que le choix de Nunca fue pena mayor (« Jamais ne fut douleur plus grande ») comme « thème unificateur » teinte fortement de dévotion mariale, la souffrance extrême étant celle de la mère au spectacle de son fils mourant sur la croix, est peut-être, comme souvent chez Peñalosa, son extrême sobriété conjuguée à de remarquables capacités d’invention. Le traitement de la mélodie de la chanson est, à cet égard, révélateur, car si elle se déploie dans toute sa nudité à la voix supérieure dès le premier Kyrie en demeurant parfaitement perceptible et identifiable, le compositeur va ensuite faire montre d’une grande imagination dans son traitement, par exemple en brodant dessus (Christe) ou en la combinant avec des mélodies grégoriennes (Gloria, Credo). Bien que de tels procédés révèlent une maîtrise certaine des techniques d’écriture, l’œuvre sonne néanmoins toujours avec beaucoup de clarté et de simplicité, loin du caractère parfois extrêmement complexe et un rien ostentatoire des polyphonies développées en Flandres. Les mêmes qualités se retrouvent dans les motets proposés en complément de programme, certains d’attribution contestable, comme Memorare Piissima, probablement dû à Pedro de Escobar (c.1465-après 1535), qui semblent marqués par une volonté supérieure d’expressivité, prenant l’auditeur à partie pour mieux le conduire à la méditation, comme le montrent l’utilisation des silences dans Ave vera caro Christi ou la dramatisation d’In passione positus.
Ceux qui suivent attentivement le parcours de l’Ensemble Gilles Binchois (photographie ci-dessous) savent que Dominique Vellard a toujours montré un intérêt particulier pour le répertoire hispanique, comme le prouvent deux superbes disques consacrés à Escobar (Requiem, Virgin, 1998, et Missa in Granada, Christophorus, 2003) ; il revient à ses premières amours avec la Missa Nunca fue pena mayor, puisque c’est avec cette œuvre qu’il avait choisi d’inaugurer le parcours discographique de son ensemble en 1981. Enregistré dans la superbe acoustique de la cathédrale de Maguelone, parfaitement maîtrisée et restituée par la prise de son toute en finesse d’Aline Blondiau, ce disque s’impose d’emblée par la cohérence de ses choix esthétiques et la sensation d’intériorité qu’il dégage. Le programme, composé avec une indéniable intelligence, replace la messe dans le contexte de la Passion, une option complètement valable et défendue avec un réel souci d’expressivité et de variété par les chanteurs, mais aussi par les instrumentistes des Sacqueboutiers dont les interventions, que d’aucuns trouveront peut-être historiquement discutables, sont réalisées avec un naturel et un discernement qui les honorent.  La réalisation vocale est de très bon niveau et parvient à rendre pleinement justice à la simplicité presque austère de la musique tout en faisant saillir son inventivité et en lui apportant la densité et l’animation qu’elle requiert. Si l’on excepte quelques tensions ou fluctuations ponctuelles dans les registres aigus, d’ailleurs largement compensées par l’implication des chanteurs, l’ensemble sonne avec beaucoup de plénitude et de transparence, sans que la personnalité de chaque voix soit pour autant diminuée ou effacée. En s’appuyant sur leur connaissance et leur pratique des répertoires antérieurs, Dominique Vellard et ses chantres livrent une vision très orante et concentrée de la messe comme des motets, dont les élans les plus progressistes luisent peut-être avec d’autant plus d’éclat que l’on perçoit ici avec netteté la tradition dans laquelle ils s’inscrivent. Leur disque prend donc tout naturellement place parmi les meilleurs consacrés à Peñalosa.
La réalisation vocale est de très bon niveau et parvient à rendre pleinement justice à la simplicité presque austère de la musique tout en faisant saillir son inventivité et en lui apportant la densité et l’animation qu’elle requiert. Si l’on excepte quelques tensions ou fluctuations ponctuelles dans les registres aigus, d’ailleurs largement compensées par l’implication des chanteurs, l’ensemble sonne avec beaucoup de plénitude et de transparence, sans que la personnalité de chaque voix soit pour autant diminuée ou effacée. En s’appuyant sur leur connaissance et leur pratique des répertoires antérieurs, Dominique Vellard et ses chantres livrent une vision très orante et concentrée de la messe comme des motets, dont les élans les plus progressistes luisent peut-être avec d’autant plus d’éclat que l’on perçoit ici avec netteté la tradition dans laquelle ils s’inscrivent. Leur disque prend donc tout naturellement place parmi les meilleurs consacrés à Peñalosa.
Je vous recommande donc cet enregistrement dédié à un musicien qui n’a pas encore complètement acquis, à mon avis, la place qu’il devrait avoir dans le paysage de la musique du XVIe siècle et dont les œuvres sont ici particulièrement bien servies par l’Ensemble Gilles Binchois. Puisse cette réalisation de grande qualité donner l’envie aux musiciens et aux éditeurs de se lancer dans l’exploration des cinq autres messes de Peñalosa, mais aussi de ses lamentations, peu ou imparfaitement documentées au disque.
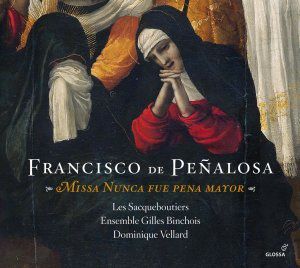 Francisco de Peñalosa (c.1470-1528), Missa Nunca fue pena mayor, hymnes et motets.
Francisco de Peñalosa (c.1470-1528), Missa Nunca fue pena mayor, hymnes et motets.
Ensemble Gilles Binchois
Les Sacqueboutiers
Dominique Vellard, direction
1 CD [durée totale : 58’43”] Glossa GCD 922305. Ce disque peut être acheté en suivant ce lien.
Extraits proposés :
1. Missa Nunca fue pena mayor : Kyrie
2. Missa Nunca fue pena mayor : Agnus Dei
3. In passione positus Iesus, motet
Illustration complémentaire :
Attribué à Michel Sittow (Reval, c.1469-1525/26), Portrait de Ferdinand d’Aragon, c.1500. Huile sur bois, 29 x 22 cm, Vienne, Kunsthistorisches Museum.
La photographie de l’Ensemble Gilles Binchois et des Sacqueboutiers est de Roxanne Gauthier. Je remercie l’Ensemble Gilles Binchois de m’avoir autorisé à l’utiliser.
Je remercie Philippe Leclant, directeur du Festival de Maguelone, d’avoir rendu possible la réalisation de cette chronique.





 Ce contexte matériel très favorable va probablement jouer un rôle de puissant stimulant auprès des musiciens et les inciter à élargir et à diversifier leur répertoire. Outre les habituelles danses, ils vont continuer à composer des arrangements de plus en plus élaborés de chansons à la mode, comme le montrent, dans ce disque, des pièces s’inspirant de celles de Claudin de Sermisy, Thomas Crecquillon, Pierre Sandrin ou de l’inévitable Josquin des Prés, de psaumes voire de mouvements de messe, mais aussi créer de nouvelles formes leur permettant de faire montre de leur savoir-faire tant contrapuntique que mélodique et, le plus souvent, de leur talent de virtuose. C’est ainsi que naissent nombre de préludes, ricercares et fantaisies (ces deux termes étant, à l’époque, interchangeables), élaborations toujours plus savantes et complexes dont témoigne la production conservée de deux Italiens, l’un actif dans son pays, Francesco da Milano (1497-1543), l’autre principalement en France, Alberto da Mantova, dit Albert de Rippe (c.1500-1552), arrivé à la cour de François Ier à partir de mai 1529. Les livres de comptes gardant trace des salaires faramineux qui leur étaient octroyés par leurs prestigieux employeurs, les hommages admiratifs que leur rendirent poètes et chroniqueurs de leur vivant comme après leur mort attestent de leur fabuleuse renommée et du charme exercé sur les auditoires par ces deux luthistes dont on peut dire qu’ils contribuèrent à changer la face du répertoire dédié à leur instrument.
Ce contexte matériel très favorable va probablement jouer un rôle de puissant stimulant auprès des musiciens et les inciter à élargir et à diversifier leur répertoire. Outre les habituelles danses, ils vont continuer à composer des arrangements de plus en plus élaborés de chansons à la mode, comme le montrent, dans ce disque, des pièces s’inspirant de celles de Claudin de Sermisy, Thomas Crecquillon, Pierre Sandrin ou de l’inévitable Josquin des Prés, de psaumes voire de mouvements de messe, mais aussi créer de nouvelles formes leur permettant de faire montre de leur savoir-faire tant contrapuntique que mélodique et, le plus souvent, de leur talent de virtuose. C’est ainsi que naissent nombre de préludes, ricercares et fantaisies (ces deux termes étant, à l’époque, interchangeables), élaborations toujours plus savantes et complexes dont témoigne la production conservée de deux Italiens, l’un actif dans son pays, Francesco da Milano (1497-1543), l’autre principalement en France, Alberto da Mantova, dit Albert de Rippe (c.1500-1552), arrivé à la cour de François Ier à partir de mai 1529. Les livres de comptes gardant trace des salaires faramineux qui leur étaient octroyés par leurs prestigieux employeurs, les hommages admiratifs que leur rendirent poètes et chroniqueurs de leur vivant comme après leur mort attestent de leur fabuleuse renommée et du charme exercé sur les auditoires par ces deux luthistes dont on peut dire qu’ils contribuèrent à changer la face du répertoire dédié à leur instrument.
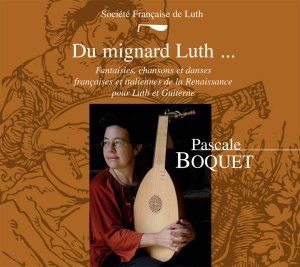 Du mignard Luth… Fantaisies, chansons et danses françaises et italiennes de la Renaissance pour luth et guiterne
Du mignard Luth… Fantaisies, chansons et danses françaises et italiennes de la Renaissance pour luth et guiterne


 Giuseppe Sammartini (1695-1750), Concertos & Overtures.
Giuseppe Sammartini (1695-1750), Concertos & Overtures.


 Je vous recommande donc tout particulièrement ces Lessons of Worthe offertes avec autant de brio que de sensibilité par Bertrand Cuiller qui confirme, disque après disque, qu’il est un claveciniste majeur de notre temps, un de ceux qui, par la cohérence de leur démarche et le soin qu’ils apportent à leurs réalisations, réussissent à être de parfaits ambassadeurs de leur instrument. On attend avec confiance et enthousiasme les prochaines leçons que voudra bien nous délivrer cet artiste dont plus personne aujourd’hui ne doute de la valeur.
Je vous recommande donc tout particulièrement ces Lessons of Worthe offertes avec autant de brio que de sensibilité par Bertrand Cuiller qui confirme, disque après disque, qu’il est un claveciniste majeur de notre temps, un de ceux qui, par la cohérence de leur démarche et le soin qu’ils apportent à leurs réalisations, réussissent à être de parfaits ambassadeurs de leur instrument. On attend avec confiance et enthousiasme les prochaines leçons que voudra bien nous délivrer cet artiste dont plus personne aujourd’hui ne doute de la valeur.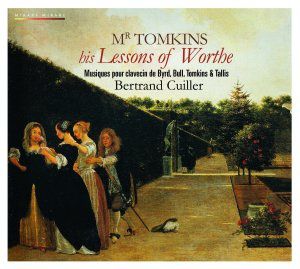 Mr Tomkins his Lessons of Worthe, pièces pour clavier de William Byrd (c.1539/40-1623), John Bull (c.1562-1628), Thomas Tomkins (1572-1656) et Thomas Tallis (c.1505-1585).
Mr Tomkins his Lessons of Worthe, pièces pour clavier de William Byrd (c.1539/40-1623), John Bull (c.1562-1628), Thomas Tomkins (1572-1656) et Thomas Tallis (c.1505-1585).
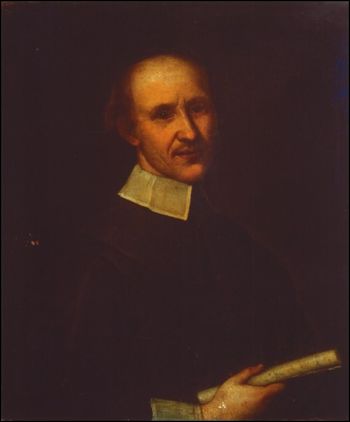

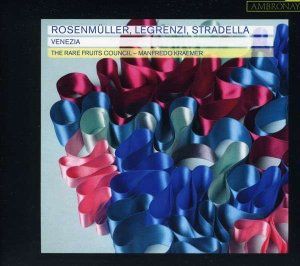 Venezia, sonates et sinfonie de Johann Rosenmüller (c.1619-1684), Giovanni Legrenzi (1626-1690) et Alessandro Stradella (1639-1682).
Venezia, sonates et sinfonie de Johann Rosenmüller (c.1619-1684), Giovanni Legrenzi (1626-1690) et Alessandro Stradella (1639-1682).
 Malgré des conflits où il résista à des ennemis souvent plus puissants que lui, comme, entre autres, les Russes, le pays put jouir, en effet, d’un système politique largement démocratique et d’une liberté religieuse enviés ailleurs en Europe qui se révélèrent autant de facteurs propices à l’éclosion de la brillante culture qui va marquer les règnes de Sigismond III (1587-1632), ardent défenseur de la Contre-Réforme, et de Ladislav IV (1632-1648), souverain très attaché à la paix. La période connue d’activité de Marcin Mielczewski, principal compositeur documenté dans ce disque, sans doute né à la charnière entre le
Malgré des conflits où il résista à des ennemis souvent plus puissants que lui, comme, entre autres, les Russes, le pays put jouir, en effet, d’un système politique largement démocratique et d’une liberté religieuse enviés ailleurs en Europe qui se révélèrent autant de facteurs propices à l’éclosion de la brillante culture qui va marquer les règnes de Sigismond III (1587-1632), ardent défenseur de la Contre-Réforme, et de Ladislav IV (1632-1648), souverain très attaché à la paix. La période connue d’activité de Marcin Mielczewski, principal compositeur documenté dans ce disque, sans doute né à la charnière entre le 
 Marcin Mielczewski (?-1651), Virgo prudentissima, œuvres sacrées et instrumentales de Giovanni Gabrieli (c.1554-1612), Tarquinio Merula (1595-1665), Francesco Usper (c.1560-1641), Bartłomiej Pękiel (début
Marcin Mielczewski (?-1651), Virgo prudentissima, œuvres sacrées et instrumentales de Giovanni Gabrieli (c.1554-1612), Tarquinio Merula (1595-1665), Francesco Usper (c.1560-1641), Bartłomiej Pękiel (début 



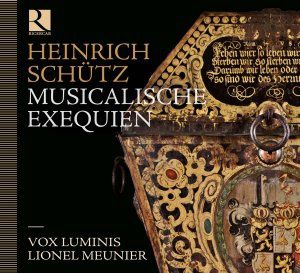 Heinrich Schütz (1585-1672), Musikalische Exequien, SWV 279-281. Motets Herr nun lässest Du deinen Diener in Friede Fahren, SWV 432 & 433, Ich bin die Auferstehung, SWV 464, Das ist ja gewißlich wahr, SWV 277. Martin Luther (1483-1546), Mit Fried und Freud ich fahr dahin. Samuel Scheidt (1587-1654), Wir glauben all an einen Gott*.
Heinrich Schütz (1585-1672), Musikalische Exequien, SWV 279-281. Motets Herr nun lässest Du deinen Diener in Friede Fahren, SWV 432 & 433, Ich bin die Auferstehung, SWV 464, Das ist ja gewißlich wahr, SWV 277. Martin Luther (1483-1546), Mit Fried und Freud ich fahr dahin. Samuel Scheidt (1587-1654), Wir glauben all an einen Gott*.


 Antonio Vivaldi (1678-1741), Vespro a San Marco. Domine ad adjuvandum, RV593, Dixit Dominus, RV807, Confitebor, RV596, Beatus vir, RV795, Laudate pueri, RV600, Lauda Jerusalem, RV609, Magnificat, RV610, Laetatus sum, RV607.
Antonio Vivaldi (1678-1741), Vespro a San Marco. Domine ad adjuvandum, RV593, Dixit Dominus, RV807, Confitebor, RV596, Beatus vir, RV795, Laudate pueri, RV600, Lauda Jerusalem, RV609, Magnificat, RV610, Laetatus sum, RV607.



 Jauchzet dem Herren, les Psaumes de David au
Jauchzet dem Herren, les Psaumes de David au 


 Johann Valentin Meder (1649-1719), Passion-oratorio selon Saint Matthieu
Johann Valentin Meder (1649-1719), Passion-oratorio selon Saint Matthieu