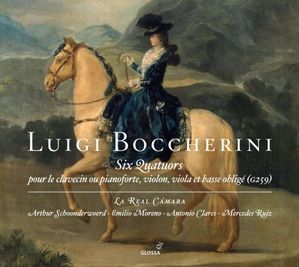Gérard de Lairesse (Liège, 1641-Amsterdam, 1711),
Paysage italianisant avec une villa, c.1687
Huile sur toile, 2,90 x 2,12 m, Amsterdam, Rijksmuseum
Sans battre tambour mais en fédérant autour de ses propositions un nombre grandissant de fidèles, l'Ensemble Masques fait son chemin avec constance et ténacité. Quelques mois après avoir offert, chez Atma, un fort beau disque Rosenmüller, il vient de rejoindre Zig-Zag Territoires chez lequel il fait son entrée en signant un enregistrement entièrement consacré à Johann Heinrich Schmelzer.
Ce compositeur, le premier non-italien à accéder, quelques mois avant de mourir de la peste à Prague en mars 1680, au poste de Kapellmeister de la cour d'Autriche, a eu la chance d'être redécouvert relativement tôt par le mouvement que l'on nommera, faute de terme plus approprié, « historiquement informé », puisque Nikolaus Harnoncourt consacra, au tout début des années 1970, une anthologie à ses sonates et notamment à celles du recueil Sacro-profanus concentus musicus, d'après lequel il avait nommé son célèbre ensemble. Ce même ouvrage, publié en 1662, constitue le cœur de la réalisation de l'Ensemble Masques, qui en donne à entendre la moitié. Même si l'usage de formes fuguées et un goût certain pour la densité contrapuntique (Sonata IX) ancrent cette musique dans la tradition septentrionale, c'est vers l'Italie qu'elle ne cesse de porter son regard,  non tant parce qu'elle se complaît dans la brillante virtuosité qui sera celle des sonates pour violon à venir (on songe au recueil fondateur que sont les Sonatæ unarum fidium de 1664), mais parce qu'on y retrouve, même avec un effectif instrumental aussi réduit, des traces de polychoralité, dont Schmelzer devait avoir une connaissance approfondie grâce à l'enseignement d'Antonio Bertali, ainsi qu'une attention particulière portée à la fluidité mélodique et au caractère chantant des harmonies. Le même esprit préside aux pièces de caractère et ballet donnés en complément de programme, mais leur destination leur autorise plus de liberté et surtout de pittoresque. Ainsi des effluves populaires imprègnent-ils, quelques décennies avant Telemann, les Cornemuses polonaises (Polnische Sackpfeiffen, 1665), tandis qu'un basson s'invite au Jour des haricots (Al giorne delle correggie, 1676) pour imiter drôlatiquement les flatulences provoquées par ce plat offert chaque année aux travailleurs par leur patron, et que l'École d'escrime (Die Fechtschule, 1668) dépeint avec force détails, comme le cliquetis des armes, et une bonne dose d'humour un combat que nous dirions aujourd'hui d'opérette. Le parcours s'achève dans une ambiance plus recueillie, avec le célèbre Lamento sopra la morte Ferdinandi III (1657) qui respecte les usages du temps en matière de Tombeaux musicaux en débutant dans une atmosphère assombrie pour finir de façon plus légère et lumineuse, probablement pour signifier que le défunt connaît au Paradis la joie des Bienheureux.
non tant parce qu'elle se complaît dans la brillante virtuosité qui sera celle des sonates pour violon à venir (on songe au recueil fondateur que sont les Sonatæ unarum fidium de 1664), mais parce qu'on y retrouve, même avec un effectif instrumental aussi réduit, des traces de polychoralité, dont Schmelzer devait avoir une connaissance approfondie grâce à l'enseignement d'Antonio Bertali, ainsi qu'une attention particulière portée à la fluidité mélodique et au caractère chantant des harmonies. Le même esprit préside aux pièces de caractère et ballet donnés en complément de programme, mais leur destination leur autorise plus de liberté et surtout de pittoresque. Ainsi des effluves populaires imprègnent-ils, quelques décennies avant Telemann, les Cornemuses polonaises (Polnische Sackpfeiffen, 1665), tandis qu'un basson s'invite au Jour des haricots (Al giorne delle correggie, 1676) pour imiter drôlatiquement les flatulences provoquées par ce plat offert chaque année aux travailleurs par leur patron, et que l'École d'escrime (Die Fechtschule, 1668) dépeint avec force détails, comme le cliquetis des armes, et une bonne dose d'humour un combat que nous dirions aujourd'hui d'opérette. Le parcours s'achève dans une ambiance plus recueillie, avec le célèbre Lamento sopra la morte Ferdinandi III (1657) qui respecte les usages du temps en matière de Tombeaux musicaux en débutant dans une atmosphère assombrie pour finir de façon plus légère et lumineuse, probablement pour signifier que le défunt connaît au Paradis la joie des Bienheureux.
Sauf erreur de ma part, aucune des pièces du programme de l'Ensemble Masques n'est inédite et il affronte donc, entre autres, la concurrence d'un disque déjà ancien, mais réédité il y a peu, d'Armonico Tributo Austria et Lorenz Duftschmid (Arcana, 1996/2010), et celle d'une réalisation plus récente du Freiburger BarockConsort (Harmonia Mundi, 2012), deux approches différentes et convaincantes. La lecture des jeunes musiciens, dirigés avec fermeté et précision du clavecin par Olivier Fortin, se caractérise, dès les premières minutes du disque, par un raffinement et une sensualité qui ne se démentiront ensuite à aucun moment.  Tout est parfaitement en place, les instrumentistes, pris individuellement, sont tous en pleine possession de leurs moyens techniques qu'ils mettent le plus humblement du monde au service d'un collectif que l'on sent très soudé et soucieux de parfaitement s'entendre, dans tous les sens de ce verbe. Ce refus de la démonstration, s'il est parfaitement en situation dans les sept sonates extraites du Sacro-profanus concentus musicus et dans le Lamento qui appartiennent à ce que la rhétorique nomme le style élevé, bride peut-être un rien l'humour des trois pièces descriptives qui constituent un théâtre en musique où il est possible et même souhaitable de lâcher un peu plus la bride à une certaine truculence. Malgré cette minime réserve, on se laisse très vite séduire par ce son à la fois soyeux et charnu, parfaitement capturé par Aline Blondiau, par cette douceur sans mollesse ni fadeur qui donne à bien des sonates un caractère chantant que l'on ne retrouve à ce point, à ma connaissance, dans aucune autre interprétation, par une approche pleine de nuances et d'un esprit qui souvent confère à ces œuvres trop souvent cantonnées à de brillants étalages de virtuosité, une densité, voire une noblesse inattendues.
Tout est parfaitement en place, les instrumentistes, pris individuellement, sont tous en pleine possession de leurs moyens techniques qu'ils mettent le plus humblement du monde au service d'un collectif que l'on sent très soudé et soucieux de parfaitement s'entendre, dans tous les sens de ce verbe. Ce refus de la démonstration, s'il est parfaitement en situation dans les sept sonates extraites du Sacro-profanus concentus musicus et dans le Lamento qui appartiennent à ce que la rhétorique nomme le style élevé, bride peut-être un rien l'humour des trois pièces descriptives qui constituent un théâtre en musique où il est possible et même souhaitable de lâcher un peu plus la bride à une certaine truculence. Malgré cette minime réserve, on se laisse très vite séduire par ce son à la fois soyeux et charnu, parfaitement capturé par Aline Blondiau, par cette douceur sans mollesse ni fadeur qui donne à bien des sonates un caractère chantant que l'on ne retrouve à ce point, à ma connaissance, dans aucune autre interprétation, par une approche pleine de nuances et d'un esprit qui souvent confère à ces œuvres trop souvent cantonnées à de brillants étalages de virtuosité, une densité, voire une noblesse inattendues.
Voici donc un disque Schmelzer réussi qui prend place sans pâlir aux côtés de ses prestigieux prédécesseurs et que chacun découvrira avec un réel plaisir. Une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, on apprenait, il y quelques jours, que l'Ensemble Masques s'apprêtait à enregistrer sous peu un nouvel opus, cette fois heureusement consacré à des pièces un peu moins fréquentées, celles de Michel Corrette (1707-1795). Voici donc un projet que l'on suivra avec bienveillance et attention.
 Johann Heinrich Schmelzer (c.1620/23-1680), Sacro-profanus : sonates à 5 et à 6 extraites du Sacro-profanus concentus musicus, Al giorno delle correggie, Die Fechtschule, Polnsiche Sackpfeiffen, Lamento sopra la morte Ferdinandi III
Johann Heinrich Schmelzer (c.1620/23-1680), Sacro-profanus : sonates à 5 et à 6 extraites du Sacro-profanus concentus musicus, Al giorno delle correggie, Die Fechtschule, Polnsiche Sackpfeiffen, Lamento sopra la morte Ferdinandi III
Ensemble Masques
Olivier Fortin, clavecin & direction
1 CD [durée totale : 53'55"] Zig-Zag Territoires ZZT 334. Ce disque peut être acheté en suivant ce lien.
Extraits proposés :
1. Sonata IX a cinque
2. Sonata a cinque par camera : Al giorno delle correggie
Un extrait de chaque plage du disque peut être écouté ci-dessous grâce à Qobuz.com :
Illustrations complémentaires :
Johann Heinrich Schmelzer en 1658. Dessin à la plume anonyme.
La photographie de l'Ensemble Masques est de Franck Ferville, utilisée avec autorisation.







 Je regarde, côte à côte sur leur bout d'étagère, le plastique usé du boîtier de l'Opus 6 de l'Ensemble 415 qu'effleure aujourd'hui le cartonnage encore lisse de celui des Incogniti. Bien sûr, ce dernier a fait prendre quelques rides à son glorieux aîné, bien sûr, si l'on doit conseiller aujourd'hui une version de ces concerti grossi, c'est vers celle d'Amandine Beyer que l'on se tournera sans hésiter, tant elle semble réunir toutes les qualités que l'on peut attendre dans l'interprétation de ce répertoire. Cependant, il me semble qu'il existe, entre ces deux réalisations si différentes, des liens tellement évidents qu'elles se complètent plus qu'elles se concurrencent, et en allant de l'une à l'autre, on prend conscience qu'on n'a pas assisté à un évincement, mais à un passage de témoin.
Je regarde, côte à côte sur leur bout d'étagère, le plastique usé du boîtier de l'Opus 6 de l'Ensemble 415 qu'effleure aujourd'hui le cartonnage encore lisse de celui des Incogniti. Bien sûr, ce dernier a fait prendre quelques rides à son glorieux aîné, bien sûr, si l'on doit conseiller aujourd'hui une version de ces concerti grossi, c'est vers celle d'Amandine Beyer que l'on se tournera sans hésiter, tant elle semble réunir toutes les qualités que l'on peut attendre dans l'interprétation de ce répertoire. Cependant, il me semble qu'il existe, entre ces deux réalisations si différentes, des liens tellement évidents qu'elles se complètent plus qu'elles se concurrencent, et en allant de l'une à l'autre, on prend conscience qu'on n'a pas assisté à un évincement, mais à un passage de témoin.

































 Je vous recommande donc sans hésitation cet English royal funeral music qui constitue un splendide hommage à la musique britannique du
Je vous recommande donc sans hésitation cet English royal funeral music qui constitue un splendide hommage à la musique britannique du