Ensemble Jacques Moderne, 7 mars 2013
Photographie © Gérard Proust
Paradoxe à la mode de Tours. Il régnait, en ce soir de mars, une température presque printanière autour de l'église Saint-Julien, probablement la plus belle de la ville – la seule, en tout cas, à posséder une tour-porche romane –, miraculeusement réchappée des bombardements de la dernière guerre, mais dès que l'on pénétrait dans la nef, une fraîcheur toute hivernale s'abattait sur les épaules. Fallait-il conjecturer un démarrage en chaud-froid pour les Nouvelles musiques anciennes, mini-festival qui n'ose pas encore dire son nom et propose, en mars et en octobre de cette année 2013, des concerts des cinq principaux ensembles spécialisés de la cité ligérienne ?
Les lecteurs qui me font l'honneur de suivre les publications de ce blog se souviendront peut-être qu'en juin 2011, j'avais rendu compte d'une précédente prestation que l'Ensemble Jacques Moderne consacrait à la musique allemande du XVIIe siècle, qui n'est malheureusement plus aujourd'hui de celles qui remplissent les salles ou enchantent les éditeurs discographiques, mais que Joël Suhubiette défend avec une constance qu'il convient de saluer. Le chef, qui fut durant huit ans l'assistant d'un fin connaisseur de ce répertoire, Philippe Herreweghe, avait courageusement choisi de proposer, pour ce concert inaugural, un programme quasi monographique consacré à la grande figure de ce siècle à la fois foisonnant et terrible pour l'Allemagne, Heinrich Schütz.
Le parcours du Sagittarius est suffisamment connu pour que l'on n'en évoque que les grandes lignes. Ce fils de bourgeois aisés – son père était aubergiste – eut la chance de voir ses précoces talents musicaux repérés par le landgrave Moritz de Hesse-Kassel qui, amateur éclairé, entendit chanter le jeune garçon lorsqu'il vint passer une nuit dans l'établissement de ses parents en 1598 et finit par convaincre ces derniers de lui confier leur fils afin qu'il pourvoie à son éducation musicale. Les promesses de Heinrich ne furent pas sans lendemain et il excella si vite dans son art que son protecteur l'envoya en 1609 parfaire ses connaissances à Venise, auprès de Giovanni Gabrieli. Ce séjour qui dura au moins jusqu'à la mort de ce maître, en août 1612, mais probablement un an au-delà, marqua Schütz de manière définitive et fit de lui un des principaux introducteurs (mais ni le premier, ni le seul, contrairement à ce qu'on lit encore parfois) de la manière italienne, alors considérée comme le parangon de la modernité, en territoires germaniques. À son retour dans sa patrie, il entama une carrière qui, si elle ne fut pas exempte de vicissitudes, devait le conduire aux plus hautes fonctions. En service à la cour de Hesse dès 1613, il fut rapidement prêté à celle de Dresde, ponctuellement en 1614, puis, à partir de 1615, pour une durée de deux ans qui devait s'avérer définitive ; en dehors d'un second voyage en Italie en 1628-29, de quelques séjours dans différentes cours, celle du Danemark durant presque deux ans (1633-35) puis 18 mois (1642-44), celles de Hildesheim et d'Hanovre de l'été 1639 au tout début de 1641, ainsi qu'un très bref passage à Wolfenbüttel (1644-45), l'essentiel de la carrière de Schütz se déroula, en effet, sur les bords de l'Elbe jusqu'à sa mort, le 6 novembre 1672, à l'âge respectable de 87 ans.
La Guerre de Trente Ans qui dévasta l'Allemagne de 1618 à 1648 laissa une profonde empreinte sur la production du musicien, comme le démontrent ses Kleine geistliche Konzerte (Petits concerts spirituels) publiés en deux parties respectivement en 1636 et 1639, et qui sont vraiment des « œuvres de guerre » par les effectifs extrêmement restreints qu'elles requièrent – voix et basse continue – mais aussi par leur concentration, laquelle met particulièrement les textes en valeur, une des constantes de l'art de Schütz qui fut, plus d'un demi-siècle avant Bach, un illustrateur du Verbe aussi minutieux qu'inspiré ne reculant devant aucun artifice rhétorique pour transmettre son message. Si elle contient des pièces composées dans le courant de cette décennie 1630 qui vit éclore les Kleine geistliche Konzerte, la Geistliche Chormusik (Musique spirituelle pour chœur) ne parut qu'en 1648, l'année même de la fin de la guerre. Dédié aux autorités de Leipzig, ce recueil aux visées pédagogiques avouées regarde souvent vers la tradition de la Renaissance et la fait coexister avec une volonté de théâtraliser les masses sonores par une écriture vocale alternant entre style concertant et tutti qui n'est pas sans rappeler l'esprit des très italianisants Psaumes de David (1619). On ignore, en revanche, à quelle époque Schütz écrivit Die sieben Worte Jesu Christi am Kreuz (Les sept paroles du Christ en croix) ; on estime généralement que l’œuvre vit le jour avant 1657, probablement aux alentours de 1645. Construite de façon symétrique, à la manière d'un retable dont les volets ouverts mettraient en valeur la scène centrale constituée par les Paroles elles-mêmes (souvenons-nous de l'importance que revêtaient les mots pour notre musicien), elle se veut une méditation, comme l'annonce le texte de l'Introitus, destinée à inciter le fidèle, suivant une démarche chère à la Devotio moderna, à faire siennes les blessures infligées à son Sauveur durant Sa Passion, lesquelles assurent le salut du croyant ici-bas et dans l'au-delà. La mise en musique demeure sobre, avec parfois certains traits volontairement archaïsants ; seules les paroles prononcées par le Christ sont mises en valeur par un style d'écriture plus moderne et nimbées d'un accompagnement de cordes, un procédé dont Bach se souviendra. Si l'atmosphère est très largement dominée par un sentiment contemplatif, Schütz a néanmoins su lui insuffler ce qu'il faut d'animation dramatique en introduisant les personnages des deux Larrons et en distribuant le rôle de l’Évangéliste entre plusieurs tessitures (soprano, alto, ténor).
L'Ensemble Jacques Moderne a fait preuve, ce soir-ci, de l'engagement et de la finesse d'approche qui font tout le prix de ses lectures d'un répertoire dans lequel il confirme qu'il a bien des choses passionnantes à dire et tout autant de belles émotions à transmettre ; on comprend d'ailleurs difficilement que le travail de premier plan qu'il mène n'ait pas encouragé certains éditeurs à lui proposer d'enregistrer plus souvent. Bravant courageusement des conditions difficiles tant pour les instruments que pour les voix, les musiciens ont offert un concert de très haute tenue, faisant assaut de fluidité, de luminosité et d'un engagement chaleureux qui a largement contribué à faire oublier la froidure. À n'en pas douter, Joël Suhubiette sait choisir les chanteurs et les instrumentistes les mieux à même de servir ses projets. Chaque pupitre vocal s'est révélé soigneusement équilibré, avec néanmoins une légère réserve envers un contre-ténor qui m'a semblé manquer parfois de la présence nécessaire pour incarner son texte, une relative faiblesse qui n'a affecté ni des sopranos aussi sensibles qu'affirmées – une mention particulière pour l'agilité et la puissance d'Anne Magouët –, ni des ténors assurés mais sans ostentation, ni la basse Jean-Claude Sarragosse, Christ plein d'humanité et d'éloquence dans les Sieben Worte, intervenant au timbre d'une belle profondeur ailleurs. Les mêmes louanges peuvent être adressées à l'ensemble instrumental, composé de quelques fines gâchettes de la musique baroque qui ont brillé dans les deux Pavanes de Michael Praetorius judicieusement choisies en complément des pièces vocales, et ont également su apporter à ces dernières les couleurs – les violistes Sylvia Abramowicz, Jonathan Dunford et Christine Plubeau, très sollicités, ont déployé, avec le raffinement qu'on leur connaît, une palette à la fois irisée et dense – et les enluminures du texte essentielles chez Schütz, tandis que le continuo, tissé avec science et inventivité par Françoise Enock au violone, Manuel de Grange au théorbe et Emmanuel Mandrin à l'orgue positif, a assuré tout au long du concert un soutien sans faille. Tous ces talents ont trouvé en Joël Suhubiette un directeur dont l'exigence assure une cohésion parfaite, la précision une efficacité optimale et les évidentes affinités envers ce répertoire la dose d'enthousiasme nécessaire pour qu'il exprime son meilleur. Sans rien laisser au hasard, mais avec autant de souplesse que de subtilité, le chef a entraîné ses troupes avec une force de conviction qui leur a permis d'exalter toutes les richesses de ces musiques et de faire ressentir l'incroyable ferveur mêlée de tendresse qu'elles dégagent.
Ce concert, salué par le public avec une gratitude à la hauteur de son excellence, confirme l'Ensemble Jacques Moderne comme l'un des meilleurs ambassadeurs français de la musique allemande du XVIIe siècle et on espère sincèrement que son obstination à la servir finira par payer en lui valant enfin toute la reconnaissance qu'il mérite. Pour l'heure, si ces musiciens passent près de chez vous – ils donneront ce même programme à l'occasion de la proche semaine pascale, le vendredi 29 mars 2013 en l'abbaye de Fontevraud, le samedi 30 mars à la chapelle de l'Immaculée de Nantes et le dimanche 31 mars en l'église Saint-Gervais d'Onzain (41) – ne manquez pas d'aller les entendre ; la générosité avec laquelle ils offrent ces fruits de l'art de Schütz mûris en des temps terribles est un baume pour le cœur et l'esprit.
Nouvelles musiques anciennes, Tours, Église Saint-Julien, 7 mars 2013
Heinrich Schütz (1585-1672), Die sieben Worte Jesu Christi am Kreuz, SWV 418, Kleine geistliche Konzerte (extraits), Geistliche Chormusik (extraits). Michael Praetorius (c.1571-1621), deux Pavanes
Ensemble Jacques Moderne
Anne Magouët & Cécile Boucard, sopranos, Gunther Vandeven, contre-ténor, Olivier Coiffet & Marc Manodritta, ténors, Jean-Claude Sarragosse, basse
Sylvia Abramowicz & Jonathan Dunford, dessus de viole, Guillemette Hueber, ténor de viole, Christine Plubeau, basse de viole, Françoise Enock, violone, Manuel de Grange, théorbe, Emmanuel Mandrin, orgue positif
Joël Suhubiette, direction
Les photographies illustrant cette chronique sont toutes de Gérard Proust, utilisées avec autorisation.
Pour connaître les détails des prochains concerts de l'Ensemble Jacques Moderne, consultez son site internet en suivant ce lien.
Accompagnement musical :
Heinrich Schütz (1585-1672), Die sieben Worte Jesu Christi am Kreuz, SWV 418 :
I. Introitus
II. Symphonia
III. Die sieben Worte
IV. Symphonia
V. Conclusio
Agnès Mellon, soprano, Steve Dugardin, contre-ténor, Stephan van Dijck, ténor, Paul Agnew, ténor, Job Boswinkel, basse
Ricercar Consort
Philippe Pierlot, dessus de viole & direction
1 CD Ricercar 206 412, réédité sous référence RIC 280. Ce disque peut être acheté en suivant ce lien.

 7e Festival de musique de Richelieu, Champigny-sur-Veude, 4 août 2013
7e Festival de musique de Richelieu, Champigny-sur-Veude, 4 août 2013  L'air italien en France au temps de Louis XIII. 1 CD Musica Ficta MF8014 qui peut être acheté en suivant ce lien.
L'air italien en France au temps de Louis XIII. 1 CD Musica Ficta MF8014 qui peut être acheté en suivant ce lien. 












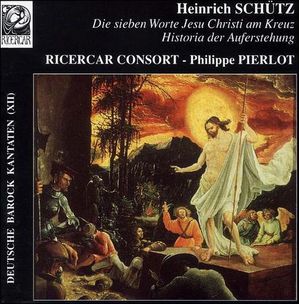



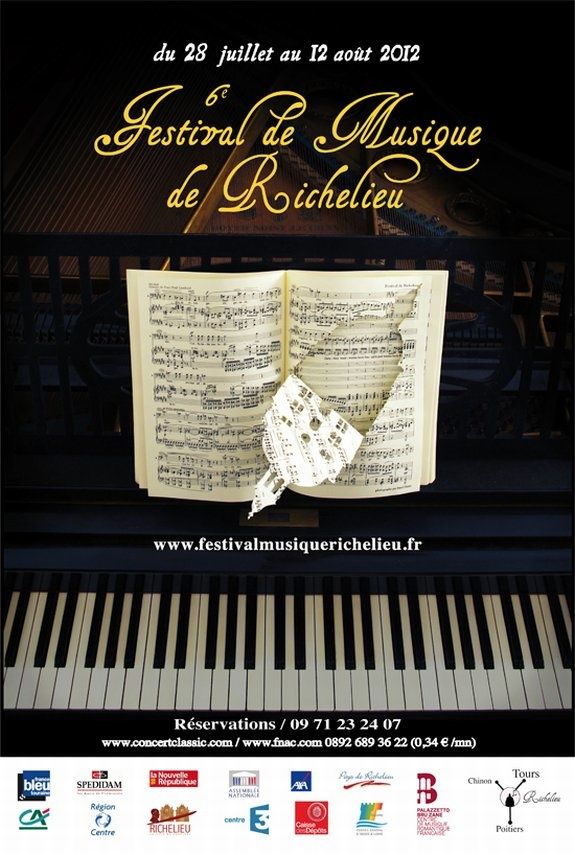







 Été musical des Douves d’Onzain (site
Été musical des Douves d’Onzain (site 




 Musicall Humors. Ce disque peut être acheté
Musicall Humors. Ce disque peut être acheté 











 Laudes, confréries d’Orient et d’Occident. 1 CD Zig-Zag Territoires ZZT 090901. Ce disque peut être acheté
Laudes, confréries d’Orient et d’Occident. 1 CD Zig-Zag Territoires ZZT 090901. Ce disque peut être acheté 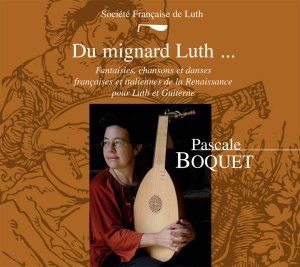 Du mignard Luth… Fantaisies, chansons et danses française et italiennes de la Renaissance. 1 CD Société française de luth SFL 1105. Ce disque peut être acheté
Du mignard Luth… Fantaisies, chansons et danses française et italiennes de la Renaissance. 1 CD Société française de luth SFL 1105. Ce disque peut être acheté  Vox Sonora, conduits de l’École de Notre-Dame. 1 CD Studio SM D2673. Ce disque peut être acheté
Vox Sonora, conduits de l’École de Notre-Dame. 1 CD Studio SM D2673. Ce disque peut être acheté  Savinien Cyrano de Bergerac (1619-1655), L’Autre Monde, ou Les Estats & Empires de la Lune. 2 CD Alpha 078. Ce double album peut être acheté
Savinien Cyrano de Bergerac (1619-1655), L’Autre Monde, ou Les Estats & Empires de la Lune. 2 CD Alpha 078. Ce double album peut être acheté  C’était bien. 1 CD EMI 724352840823. Ce disque peut être acheté
C’était bien. 1 CD EMI 724352840823. Ce disque peut être acheté 
 En dépit des réalisations, saluées en leur temps, de Thomas Binkley (1970), Paul van Nevel (1980), Alla Francesca (1993) ou Mala Punica (1997), le nom de Johannes Ciconia reste toujours assez ignoré, hors du public averti, et n’encombre pas non plus l’affiche des concerts de musique médiévale. Le bonheur de le voir apparaître sur celle du Festival « Couleurs d’été », organisé par le Conseil général d’Indre-et-Loire au Prieuré de Saint-Cosme, se doublait de celui d’entendre l’ensemble Diabolus in Musica, dont l’expertise est goûtée par un nombre croissant d’amateurs, en servir la presque totalité de la production sacrée. Si, pour les raisons de déficience de communication institutionnelle déjà évoquées dans une
En dépit des réalisations, saluées en leur temps, de Thomas Binkley (1970), Paul van Nevel (1980), Alla Francesca (1993) ou Mala Punica (1997), le nom de Johannes Ciconia reste toujours assez ignoré, hors du public averti, et n’encombre pas non plus l’affiche des concerts de musique médiévale. Le bonheur de le voir apparaître sur celle du Festival « Couleurs d’été », organisé par le Conseil général d’Indre-et-Loire au Prieuré de Saint-Cosme, se doublait de celui d’entendre l’ensemble Diabolus in Musica, dont l’expertise est goûtée par un nombre croissant d’amateurs, en servir la presque totalité de la production sacrée. Si, pour les raisons de déficience de communication institutionnelle déjà évoquées dans une 
 Jesu, meine Freude, 1 CD Ligia Digital Lidi 0202183-07. Indisponible.
Jesu, meine Freude, 1 CD Ligia Digital Lidi 0202183-07. Indisponible.