Nicolas-Antoine Taunay (Paris, 1755-1830),
Le triomphe de la guillotine, c.1795.
Huile sur toile, 129 x 168 cm, Saint-Pétersbourg, Musée de l’Ermitage.
 Il y a bientôt un an, Arnaud Marzorati, un des deux directeurs artistiques de l’ensemble Les Lunaisiens, annonçait, dans l’entretien qu’il avait eu la gentillesse de m’accorder, l’enregistrement d’un disque consacré aux chansons ayant accompagné la Révolution française. Grâce aux instruments du musée de la Cité de la musique et au soutien du Palazzetto Bru Zane, ce projet, né de la soif de redécouverte de répertoires méconnus qui constituent, pour reprendre les mots du baryton, « la musique de l’Histoire et non l’Histoire de la musique », est aujourd’hui disponible chez Alpha, sous le titre France 1789.
Il y a bientôt un an, Arnaud Marzorati, un des deux directeurs artistiques de l’ensemble Les Lunaisiens, annonçait, dans l’entretien qu’il avait eu la gentillesse de m’accorder, l’enregistrement d’un disque consacré aux chansons ayant accompagné la Révolution française. Grâce aux instruments du musée de la Cité de la musique et au soutien du Palazzetto Bru Zane, ce projet, né de la soif de redécouverte de répertoires méconnus qui constituent, pour reprendre les mots du baryton, « la musique de l’Histoire et non l’Histoire de la musique », est aujourd’hui disponible chez Alpha, sous le titre France 1789.
Lorsque l’on pense à la période révolutionnaire, des airs viennent presque automatiquement à l’esprit, qu’il s’agisse du Ça ira, de la Carmagnole ou, bien sûr, du Chant de guerre pour l’armée du Rhin, écrit à la fin d’avril 1792 et rebaptisé Marseillaise par le peuple dès le mois de juillet suivant. Certains d’entre eux connurent un tel succès qu’ils furent repris dans des œuvres « sérieuses », un des plus beaux exemples étant peut-être la Symphonie concertante pour deux violons mêlée d’airs patriotiques de Jean-Baptiste Davaux (1742-1822), publiée en 1794 (et remarquablement enregistrée par le Concerto Köln en 1989), illustrant parfaitement les échanges incessants entre musiques « savantes » et « populaires ».
Les pièces rassemblées dans cette anthologie apportent une nouvelle démonstration de cette circulation de l’un à l’autre univers, en s’attachant principalement aux chansons qui, étroitement liées au flux des événements, connurent alors une croissance phénoménale, passant d’une centaine créée en 1789 à partir de la prise de la Bastille à plus de 700 en 1794. Délaissant les salons au profit des rues dont elles capturent les tumultes, rumeurs et échos, elles voient leurs textes évoluer de façon décisive, ces derniers se faisant instantanés de l’actualité qu’ils rapportent et commentent au travers de prises à partie et de parti également virulentes , à tel point qu’on a pu dire que la Révolution française avait engendré le genre particulier, promis à un brillant avenir, de la chanson engagée. La juxtaposition d’un choix de pièces composées majoritairement entre 1790 et 1795 est particulièrement saisissante, car, loin d’être univoques comme on pourrait le supposer, ces dernières offrent le reflet d’opinions contrastées, de l’opposition acharnée à l’Ancien Régime à sa nostalgie, l’espace entre ces deux pôles extrêmes étant occupé par des positions très nuancées où se retrouvent de l’espièglerie (les Amphigouris), du désenchantement (La grande colère du Père Duchene), de la résignation (Vive la liberté), un humour parfois plutôt leste (La queue à Robespierre), qui permettent d’appréhender avec une finesse inattendue, une fois dépassée la facture quelquefois rude de textes qui, rappelons-le, sont conçus pour être immédiatement compréhensibles et n’hésitent donc pas à adopter, pour ce faire, un langage délibérément démarqué de celui du quotidien (Chanson grivoise), les différentes strates de l’humeur changeante du peuple.
, à tel point qu’on a pu dire que la Révolution française avait engendré le genre particulier, promis à un brillant avenir, de la chanson engagée. La juxtaposition d’un choix de pièces composées majoritairement entre 1790 et 1795 est particulièrement saisissante, car, loin d’être univoques comme on pourrait le supposer, ces dernières offrent le reflet d’opinions contrastées, de l’opposition acharnée à l’Ancien Régime à sa nostalgie, l’espace entre ces deux pôles extrêmes étant occupé par des positions très nuancées où se retrouvent de l’espièglerie (les Amphigouris), du désenchantement (La grande colère du Père Duchene), de la résignation (Vive la liberté), un humour parfois plutôt leste (La queue à Robespierre), qui permettent d’appréhender avec une finesse inattendue, une fois dépassée la facture quelquefois rude de textes qui, rappelons-le, sont conçus pour être immédiatement compréhensibles et n’hésitent donc pas à adopter, pour ce faire, un langage délibérément démarqué de celui du quotidien (Chanson grivoise), les différentes strates de l’humeur changeante du peuple.
Il faut également noter la facilité déconcertante avec laquelle les chansonniers, afin d’assurer à leurs créations la plus large diffusion possible, se saisissent des mélodies les plus connues pour y greffer de nouvelles paroles, qu’il s’agisse de timbres populaires, comme Cadet Rousselle ou Malbrough s’en va-t-en guerre, ou d’airs plus savants, tels l’inusable Menuet d’André-Joseph Exaudet, composé vers 1751 et ferment de quelques 200 chansons, de l’Amphigouri patriotique proposé dans ce disque à la coquine aventure de La sœur Luce,  le célébrissime Air des Trembleurs de l’Isis (1677) de Lully qui, par un succulent renversement, est mis à contribution pour célébrer la prise la Bastille, ou de compositions signées par Mondonville (Un pain d’quatr’ livres), très souvent joué au Concert Spirituel, ou par des musiciens ayant connu récemment le succès grâce à leurs opéras-comiques, comme François Devienne. Certaines partitions sont également créées sur mesure, comme le solennel Hymne à l’Être suprême de Gossec (1794), qui permet de mesurer l’impact que la manière de ce compositeur aura jusqu’au siècle suivant, entre autres sur l’œuvre de Berlioz, ou Entends ma voix, finis mes maux, une page anonyme d’inspiration clairement opératique, extrêmement intéressante et, sauf erreur de ma part, originale, où le propos politique se teinte d’une sentimentalité rousseauiste du plus bel effet préromantique.
le célébrissime Air des Trembleurs de l’Isis (1677) de Lully qui, par un succulent renversement, est mis à contribution pour célébrer la prise la Bastille, ou de compositions signées par Mondonville (Un pain d’quatr’ livres), très souvent joué au Concert Spirituel, ou par des musiciens ayant connu récemment le succès grâce à leurs opéras-comiques, comme François Devienne. Certaines partitions sont également créées sur mesure, comme le solennel Hymne à l’Être suprême de Gossec (1794), qui permet de mesurer l’impact que la manière de ce compositeur aura jusqu’au siècle suivant, entre autres sur l’œuvre de Berlioz, ou Entends ma voix, finis mes maux, une page anonyme d’inspiration clairement opératique, extrêmement intéressante et, sauf erreur de ma part, originale, où le propos politique se teinte d’une sentimentalité rousseauiste du plus bel effet préromantique.
Des Lunaisiens, on attendait le meilleur dans ce répertoire largement laissé en friche ; le moins que l’on puisse dire est qu’Arnaud Marzorati, Jean-François Novelli (photographie ci-dessous) et les musiciens qui les accompagnent dans ce projet s’acquittent tous de cette résurrection avec une aisance confondante. Si l’ensemble a fait le choix, comme l’explique fort à propos le baryton dans la partie de la notice qu’il signe, d’une esthétique sans apprêts afin de rendre au plus près le caractère direct des pièces proposées, son interprétation n’est pas, pour autant, désinvolte ou négligée ; on pourrait même dire, tout au contraire, que la virtuosité des musiciens est quelquefois bien plus éclatante que celle que requièrent des œuvres aux ambitions artistiques globalement modestes.  Qu’il s’agisse des voix ou des instruments, certains de ces derniers peu fréquentés, comme le piano organisé, le serpent ou le flageolet, tout est ici, en effet, d’une maîtrise incontestable que vient égayer un plaisir perceptible à investir les morceaux, et, en faisant un sort à chaque note et à chaque intention sans jamais les surligner plus que nécessaire, à leur insuffler ce qu’il faut de vie pour transformer chacun d’eux en un tableautin plein de nuances, des plus vives (La trahison punie) aux plus estompées (Entends ma voix, finis mes maux). Plus qu’à une lecture se conformant strictement au matériau d’origine qui se serait sans doute révélée un rien sage ou terne, les Lunaisiens se livrent ici à une véritable réinvention musicale, conduite tambour battant et sans temps mort de la première à la dernière minute du disque, avec une expressivité, une théâtralité complètement assumées et souvent jubilatoires (La queue à Robespierre, Marseillaise et Contre Marseillaise) qui emportent l’auditeur dans un véritable tourbillon d’images et d’humeurs. Tant de brio ne serait rien s’il n’était mis au service d’une véritable intelligence du répertoire et d’une connaissance très fine de l’époque dans laquelle il s’insère, les choix opérés tout au long de cette anthologie révélant un travail préalable manifestement réalisé avec autant de minutie que de passion. Il ne faire guère de doute que la réussite de cet enregistrement tient à ce dosage parfaitement pensé entre science et liberté, qui lui confère chair, séduction et vraisemblance.
Qu’il s’agisse des voix ou des instruments, certains de ces derniers peu fréquentés, comme le piano organisé, le serpent ou le flageolet, tout est ici, en effet, d’une maîtrise incontestable que vient égayer un plaisir perceptible à investir les morceaux, et, en faisant un sort à chaque note et à chaque intention sans jamais les surligner plus que nécessaire, à leur insuffler ce qu’il faut de vie pour transformer chacun d’eux en un tableautin plein de nuances, des plus vives (La trahison punie) aux plus estompées (Entends ma voix, finis mes maux). Plus qu’à une lecture se conformant strictement au matériau d’origine qui se serait sans doute révélée un rien sage ou terne, les Lunaisiens se livrent ici à une véritable réinvention musicale, conduite tambour battant et sans temps mort de la première à la dernière minute du disque, avec une expressivité, une théâtralité complètement assumées et souvent jubilatoires (La queue à Robespierre, Marseillaise et Contre Marseillaise) qui emportent l’auditeur dans un véritable tourbillon d’images et d’humeurs. Tant de brio ne serait rien s’il n’était mis au service d’une véritable intelligence du répertoire et d’une connaissance très fine de l’époque dans laquelle il s’insère, les choix opérés tout au long de cette anthologie révélant un travail préalable manifestement réalisé avec autant de minutie que de passion. Il ne faire guère de doute que la réussite de cet enregistrement tient à ce dosage parfaitement pensé entre science et liberté, qui lui confère chair, séduction et vraisemblance.
À tous ceux qui, chercheurs ou simples curieux, souhaitent découvrir le bouillonnement créatif des premières années de la Révolution française, je conseille donc ce France 1789 haut en couleurs et brillamment interprété par des Lunaisiens en grande forme. Si son caractère documentaire l’inscrit un peu en marge de la production discographique habituelle, sa pédagogie souriante rend cette réalisation passionnante assez irrésistible, et on remercie la Cité de la musique et le Palazzetto Bru Zane de l’avoir rendu possible, en espérant que ces deux institutions feront de nouveau confiance à des interprètes sans concurrents dès qu’il s’agit de sentir l’air qui passe au travers des chansons d’une époque.
 France 1789. Révolte en musique d’un sans-culotte et d’un royaliste.
France 1789. Révolte en musique d’un sans-culotte et d’un royaliste.
Les Lunaisiens :
Hughes Primard, Arnaud Ledu, ténors, Stéphanie Paulet, violon, Mélanie Flahaut, flageolet & basson, Michel Godard, serpent, Céline Frisch, clavecin, Yves Rechsteiner, piano organisé, Joël Grare, percussions.
Arnaud Marzorati, baryton & direction
Jean-François Novelli, ténor & direction
1 CD [durée totale : 61’08”] Alpha 810. Ce disque peut être acheté en suivant ce lien.
Extraits proposés :
1. La trahison punie, texte de Ladré, chansonnier patriote (1792)
Arnaud Marzorati, Mélanie Flahaut, Joël Grare
2. Vive la liberté, anonyme (1793)
3. Entends ma voix, finis mes maux, anonyme (1792)
Jean-François Novelli, Mélanie Flahaut, Céline Frisch
4. La grande colère du Père Duchene, anonyme (1791)
5. La queue à Robespierre, texte de Louis-Ange Pitou (1795)
Jean-François Novelli, Stéphanie Paulet
Illustrations complémentaires :
Anonyme français, Les aristocrates à Lanternopolis, 1790. Estampe, 27 x 20,5 cm, Paris, Bibliothèque nationale de France.
Anonyme anglais, XVIIIe siècle, La démocratie française illimitée, la monarchie française limitée, sans date. Aquarelle, 19,2 x 29,5 cm, Versailles, Château de Versailles et de Trianon.





 Ce fils d’un serviteur de la maison de la reine Isabelle est né à Talavera de la Reina vers 1470 et si l’on est réduit, comme souvent avec les musiciens de cette époque, à des conjectures pour ce qui regarde sa formation, il y a fort à parier qu’elle fut sévillane. Le 11 mai 1498, date de la première mention officielle de son nom, il est engagé en qualité de chanteur de la chapelle royale de Ferdinand II d’Aragon, au service duquel il va demeurer jusqu’à la mort du souverain, en 1516, tout en cumulant, sur le conseil de ce dernier, un canonicat à la cathédrale de Séville, auquel il postule dès la fin de l’année 1505, ainsi qu’un poste de maître de chapelle, à partir de 1511, auprès du prince Ferdinand, fils de Philippe le Beau et de Jeanne la Folle. En 1517, Peñalosa se rend à Rome pour y chanter dans le chœur papal ; il va y demeurer jusqu’à la mort du pontife en décembre 1521, une situation dont nous avons vu qu’elle n’avait pas été sans provoquer quelques tensions. À son retour en Espagne, il retrouve néanmoins son poste à la cathédrale de Séville, où ses messes se sont durablement installées au répertoire comme le démontre le recueil qui en est réalisé vers 1510-1511, et c’est tout naturellement qu’il y trouve sa sépulture à sa mort, le 1er avril 1528.
Ce fils d’un serviteur de la maison de la reine Isabelle est né à Talavera de la Reina vers 1470 et si l’on est réduit, comme souvent avec les musiciens de cette époque, à des conjectures pour ce qui regarde sa formation, il y a fort à parier qu’elle fut sévillane. Le 11 mai 1498, date de la première mention officielle de son nom, il est engagé en qualité de chanteur de la chapelle royale de Ferdinand II d’Aragon, au service duquel il va demeurer jusqu’à la mort du souverain, en 1516, tout en cumulant, sur le conseil de ce dernier, un canonicat à la cathédrale de Séville, auquel il postule dès la fin de l’année 1505, ainsi qu’un poste de maître de chapelle, à partir de 1511, auprès du prince Ferdinand, fils de Philippe le Beau et de Jeanne la Folle. En 1517, Peñalosa se rend à Rome pour y chanter dans le chœur papal ; il va y demeurer jusqu’à la mort du pontife en décembre 1521, une situation dont nous avons vu qu’elle n’avait pas été sans provoquer quelques tensions. À son retour en Espagne, il retrouve néanmoins son poste à la cathédrale de Séville, où ses messes se sont durablement installées au répertoire comme le démontre le recueil qui en est réalisé vers 1510-1511, et c’est tout naturellement qu’il y trouve sa sépulture à sa mort, le 1er avril 1528.

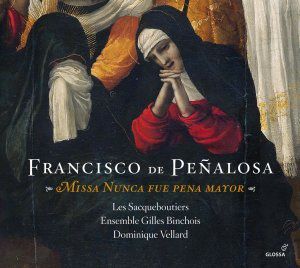 Francisco de Peñalosa (c.1470-1528), Missa Nunca fue pena mayor, hymnes et motets.
Francisco de Peñalosa (c.1470-1528), Missa Nunca fue pena mayor, hymnes et motets.


 Je vous recommande donc tout particulièrement ce double disque qui constitue, à mes yeux, un apport d’importance à la discographie de George Onslow, en ce qu’il permet de disposer d’une interprétation artistiquement de tout premier plan, car cohérente, idiomatique et sensible, de sa musique de chambre avec vents, justifiant, malgré la réserve émise quant au Nonette, l’attribution d’un Incontournable Passée des arts. On espère vivement que le Palazzetto Bru Zane permettra aux excellents musiciens de l’Ensemble Initium, ainsi qu’à Johan Farjot, de continuer à explorer le répertoire romantique écrit en France pour leurs instruments ; Reicha, Blanc, Gounod, Farrenc ou Gouvy, entre autres, n’attendent qu’eux.
Je vous recommande donc tout particulièrement ce double disque qui constitue, à mes yeux, un apport d’importance à la discographie de George Onslow, en ce qu’il permet de disposer d’une interprétation artistiquement de tout premier plan, car cohérente, idiomatique et sensible, de sa musique de chambre avec vents, justifiant, malgré la réserve émise quant au Nonette, l’attribution d’un Incontournable Passée des arts. On espère vivement que le Palazzetto Bru Zane permettra aux excellents musiciens de l’Ensemble Initium, ainsi qu’à Johan Farjot, de continuer à explorer le répertoire romantique écrit en France pour leurs instruments ; Reicha, Blanc, Gounod, Farrenc ou Gouvy, entre autres, n’attendent qu’eux.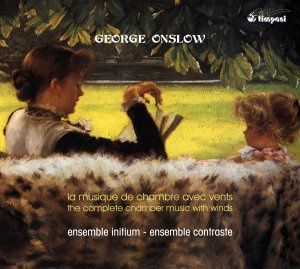 George Onslow (1784-1853), La musique de chambre avec instruments à vents.
George Onslow (1784-1853), La musique de chambre avec instruments à vents.











 Laudes, confréries d’Orient et d’Occident. 1 CD Zig-Zag Territoires ZZT 090901. Ce disque peut être acheté
Laudes, confréries d’Orient et d’Occident. 1 CD Zig-Zag Territoires ZZT 090901. Ce disque peut être acheté 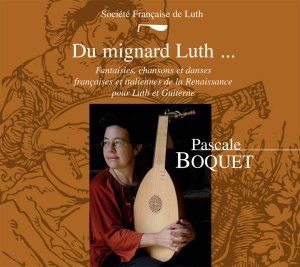 Du mignard Luth… Fantaisies, chansons et danses française et italiennes de la Renaissance. 1 CD Société française de luth SFL 1105. Ce disque peut être acheté
Du mignard Luth… Fantaisies, chansons et danses française et italiennes de la Renaissance. 1 CD Société française de luth SFL 1105. Ce disque peut être acheté  Vox Sonora, conduits de l’École de Notre-Dame. 1 CD Studio SM D2673. Ce disque peut être acheté
Vox Sonora, conduits de l’École de Notre-Dame. 1 CD Studio SM D2673. Ce disque peut être acheté  Savinien Cyrano de Bergerac (1619-1655), L’Autre Monde, ou Les Estats & Empires de la Lune. 2 CD Alpha 078. Ce double album peut être acheté
Savinien Cyrano de Bergerac (1619-1655), L’Autre Monde, ou Les Estats & Empires de la Lune. 2 CD Alpha 078. Ce double album peut être acheté  C’était bien. 1 CD EMI 724352840823. Ce disque peut être acheté
C’était bien. 1 CD EMI 724352840823. Ce disque peut être acheté 
 Ce contexte matériel très favorable va probablement jouer un rôle de puissant stimulant auprès des musiciens et les inciter à élargir et à diversifier leur répertoire. Outre les habituelles danses, ils vont continuer à composer des arrangements de plus en plus élaborés de chansons à la mode, comme le montrent, dans ce disque, des pièces s’inspirant de celles de Claudin de Sermisy, Thomas Crecquillon, Pierre Sandrin ou de l’inévitable Josquin des Prés, de psaumes voire de mouvements de messe, mais aussi créer de nouvelles formes leur permettant de faire montre de leur savoir-faire tant contrapuntique que mélodique et, le plus souvent, de leur talent de virtuose. C’est ainsi que naissent nombre de préludes, ricercares et fantaisies (ces deux termes étant, à l’époque, interchangeables), élaborations toujours plus savantes et complexes dont témoigne la production conservée de deux Italiens, l’un actif dans son pays, Francesco da Milano (1497-1543), l’autre principalement en France, Alberto da Mantova, dit Albert de Rippe (c.1500-1552), arrivé à la cour de François Ier à partir de mai 1529. Les livres de comptes gardant trace des salaires faramineux qui leur étaient octroyés par leurs prestigieux employeurs, les hommages admiratifs que leur rendirent poètes et chroniqueurs de leur vivant comme après leur mort attestent de leur fabuleuse renommée et du charme exercé sur les auditoires par ces deux luthistes dont on peut dire qu’ils contribuèrent à changer la face du répertoire dédié à leur instrument.
Ce contexte matériel très favorable va probablement jouer un rôle de puissant stimulant auprès des musiciens et les inciter à élargir et à diversifier leur répertoire. Outre les habituelles danses, ils vont continuer à composer des arrangements de plus en plus élaborés de chansons à la mode, comme le montrent, dans ce disque, des pièces s’inspirant de celles de Claudin de Sermisy, Thomas Crecquillon, Pierre Sandrin ou de l’inévitable Josquin des Prés, de psaumes voire de mouvements de messe, mais aussi créer de nouvelles formes leur permettant de faire montre de leur savoir-faire tant contrapuntique que mélodique et, le plus souvent, de leur talent de virtuose. C’est ainsi que naissent nombre de préludes, ricercares et fantaisies (ces deux termes étant, à l’époque, interchangeables), élaborations toujours plus savantes et complexes dont témoigne la production conservée de deux Italiens, l’un actif dans son pays, Francesco da Milano (1497-1543), l’autre principalement en France, Alberto da Mantova, dit Albert de Rippe (c.1500-1552), arrivé à la cour de François Ier à partir de mai 1529. Les livres de comptes gardant trace des salaires faramineux qui leur étaient octroyés par leurs prestigieux employeurs, les hommages admiratifs que leur rendirent poètes et chroniqueurs de leur vivant comme après leur mort attestent de leur fabuleuse renommée et du charme exercé sur les auditoires par ces deux luthistes dont on peut dire qu’ils contribuèrent à changer la face du répertoire dédié à leur instrument.

 En dépit des réalisations, saluées en leur temps, de Thomas Binkley (1970), Paul van Nevel (1980), Alla Francesca (1993) ou Mala Punica (1997), le nom de Johannes Ciconia reste toujours assez ignoré, hors du public averti, et n’encombre pas non plus l’affiche des concerts de musique médiévale. Le bonheur de le voir apparaître sur celle du Festival « Couleurs d’été », organisé par le Conseil général d’Indre-et-Loire au Prieuré de Saint-Cosme, se doublait de celui d’entendre l’ensemble Diabolus in Musica, dont l’expertise est goûtée par un nombre croissant d’amateurs, en servir la presque totalité de la production sacrée. Si, pour les raisons de déficience de communication institutionnelle déjà évoquées dans une
En dépit des réalisations, saluées en leur temps, de Thomas Binkley (1970), Paul van Nevel (1980), Alla Francesca (1993) ou Mala Punica (1997), le nom de Johannes Ciconia reste toujours assez ignoré, hors du public averti, et n’encombre pas non plus l’affiche des concerts de musique médiévale. Le bonheur de le voir apparaître sur celle du Festival « Couleurs d’été », organisé par le Conseil général d’Indre-et-Loire au Prieuré de Saint-Cosme, se doublait de celui d’entendre l’ensemble Diabolus in Musica, dont l’expertise est goûtée par un nombre croissant d’amateurs, en servir la presque totalité de la production sacrée. Si, pour les raisons de déficience de communication institutionnelle déjà évoquées dans une 
 Jesu, meine Freude, 1 CD Ligia Digital Lidi 0202183-07. Indisponible.
Jesu, meine Freude, 1 CD Ligia Digital Lidi 0202183-07. Indisponible.


 Giuseppe Sammartini (1695-1750), Concertos & Overtures.
Giuseppe Sammartini (1695-1750), Concertos & Overtures.
 1 CD Mirare MIR 125, Incontournable Passée des arts, chronique complète
1 CD Mirare MIR 125, Incontournable Passée des arts, chronique complète 


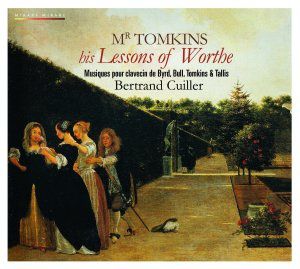 Mr Tomkins his Lessons of Worthe, pièces pour clavier de William Byrd (c.1539/40-1623), John Bull (c.1562-1628), Thomas Tomkins (1572-1656) et Thomas Tallis (c.1505-1585).
Mr Tomkins his Lessons of Worthe, pièces pour clavier de William Byrd (c.1539/40-1623), John Bull (c.1562-1628), Thomas Tomkins (1572-1656) et Thomas Tallis (c.1505-1585).